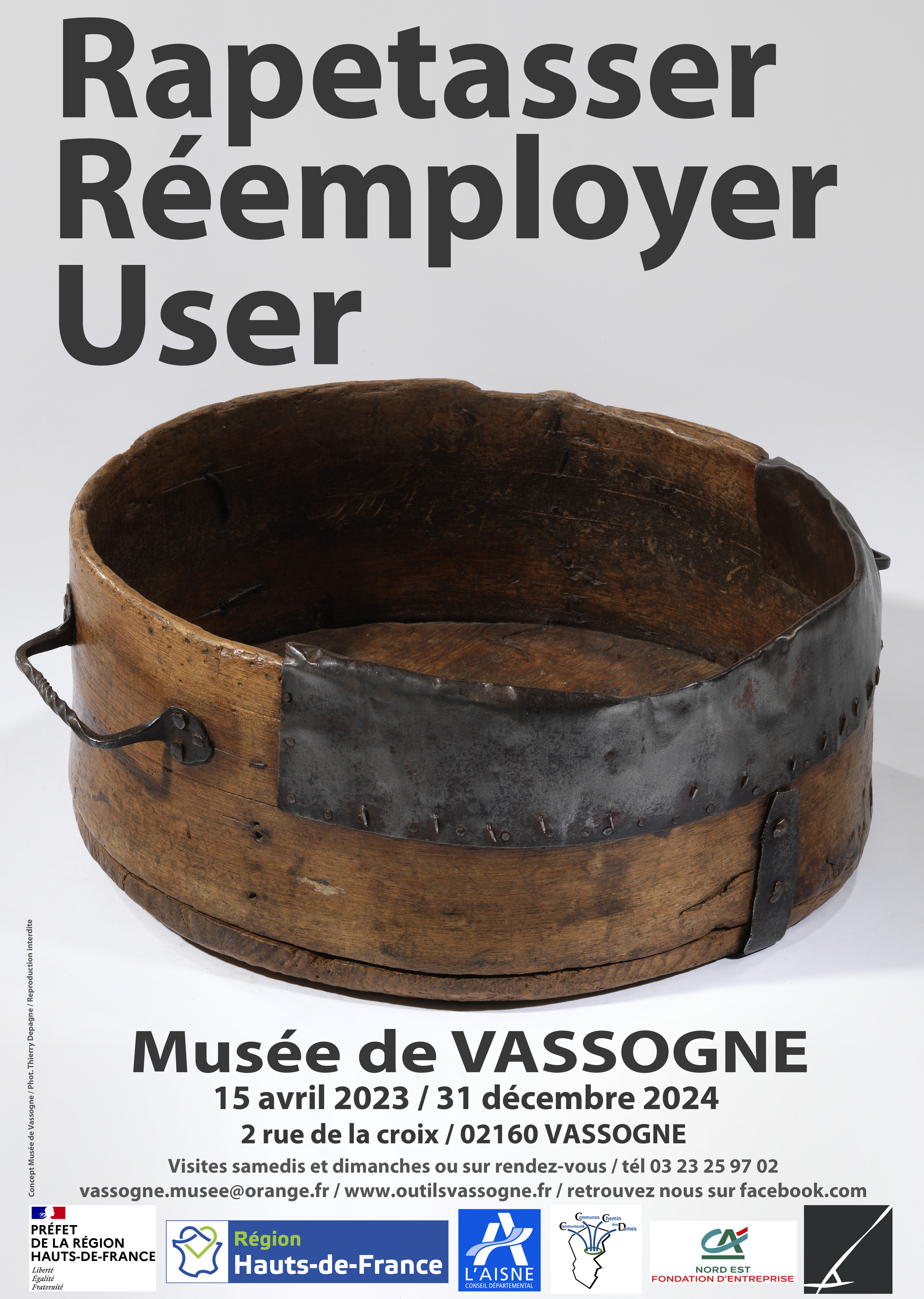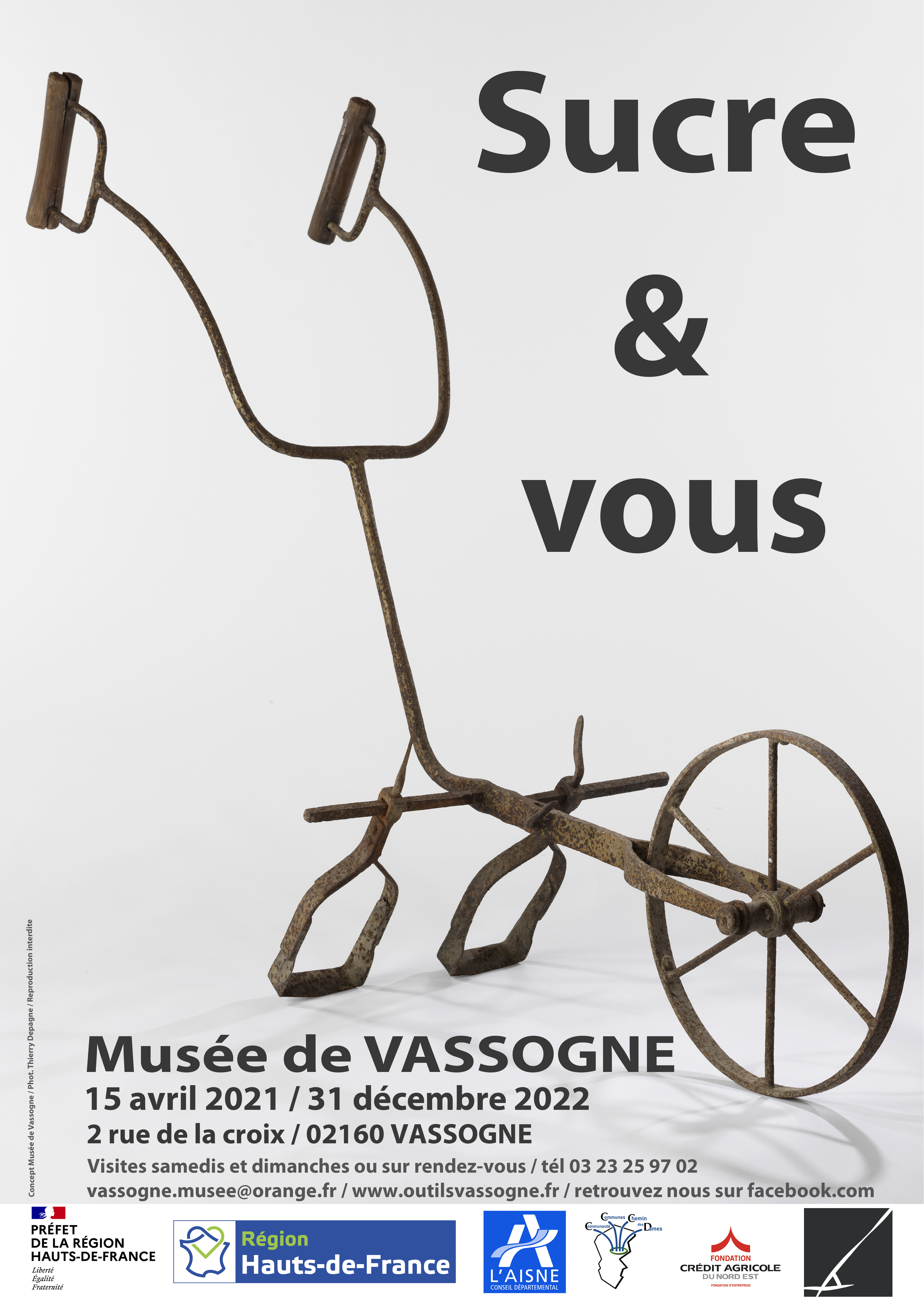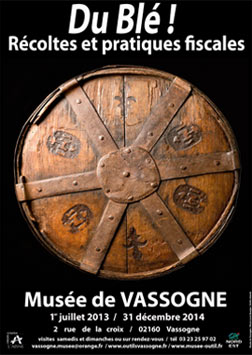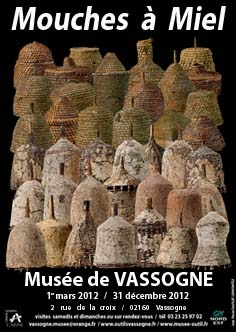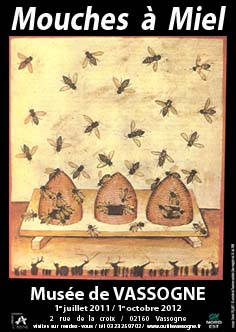Expositions passées
2023-2024 : "User, Réemployer, Rapetasser"
Un des fondamentaux du musée de Vassogne est de relier ses collections, par l’étude et le récit, à la réalité contemporaine. Il faut envisager cette réalité complexe et hyper mobile dans tous ses aspects humains, historiques, sociologiques, philosophiques, artistiques. Cette résonance prend tout son sens avec l’exposition Le Réemploi - User, réemployer, rapetasser - de l’avant-guerre à nos jours. Nous sommes à un moment où la question du réemploi et de la durabilité des objets et des produits acquiert une dimension de cause nationale. Il est révélateur que le nom d’abord envisagé pour le « Conseil national de la refondation » voulu en 2022 par le Président de la République ait été « Conseil national de la reconstruction ». De même, la création, en septembre 2022, de L’Observatoire National du Réemploi et de La Réutilisation renforce l’institutionnalisation et la visibilité - en cours déjà depuis de nombreuses années - de l’idée, de la pratique et de l’économie du réemploi. Ce qui fait aussi la différence aujourd’hui c’est que réemploi et réparation ne sont plus des pratiques plus ou moins individuelles dictées par le pragmatisme, la contrainte économique ou le système D mais sont adossées à un impératif éthique et moral : « Je réemploie donc je sauve la planète ». Cette nécessité infuse dans toutes les strates de la société et prend l’aspect d’une révolution des mentalités, au prix parfois d’une certaine récupération marchande. On notera par exemple, ces jours-ci, le slogan d’une campagne publicitaire pour une célèbre marque de bière : « Recyclable, donnons une nouvelle vie à nos bouteilles… ». Les idées aussi se réemploient. L’ampleur de cette réappropriation marque le passage difficile et nécessaire vers une nouvelle culture de la sobriété. L’acuité contemporaine du sujet ne fait pas oublier que sa pratique est aussi ancienne que l’histoire des techniques et des outils. Elle n’a en fait jamais disparu malgré le culte récent - à l’échelle du temps - de l’hyperconsommation, de l’obsolescence programmée et de l’objet à usage unique. Le présent catalogue explore différents aspects de cette histoire.
Georges Dubouchet donne de nombreux exemples de réemploi, de rapetassage, de réparation et de réutilisation dans les milieux populaires, principalement au XIXème siècle. Tous les domaines d’activité sont concernés. Tout est réparable et réparé : des parapluies aux poêles, en passant par les horloges, le mobilier et les filets de pêche, sans oublier les couteaux et les casseroles. Le rémouleur ou l’étameur sont les métiers emblématiques de ces usages. Toujours à propos du XIXème siècle, Michel Bouchez montre l’importance des pratiques couturières pour réhabiliter le linge et les tissus. Les métiers du bois, du bâtiment, du cuir, n’échappent pas à la règle. L’apparition progressive des objets manufacturés en série à la fin du siècle fait disparaître certains de ces métiers au profit de nouveaux. Les figures du quincaillier et du droguiste émergent avec la pratique individuelle du bricolage. Créé en 1866, le Grand Bazar de l’Hôtel de Ville devient le tout premier établissement parisien à proposer des articles étiquetés, vendus à prix fixes et accessibles aux classes moyennes et populaires. L’« art des tranchées », né pendant la Première Guerre Mondiale, est étudié par Jean-Pierre Boureux. Les soldats, souvent des artisans dans le civil, font passer le temps, quand ils le peuvent, et recyclent, détournent, transforment des munitions, entre autres, pour en faire de petits objets utilitaires (encriers, ronds de serviette, assiettes, etc.), des souvenirs ou des objets, de protection symboliques (« arrête-balles »), des talismans ou d’expression d’une foi religieuse. Stéphane Bedhome évoque la récupération intensive de matériaux et objets de la guerre après la fin du conflit. Il y a pénurie de tout. Tout peut servir pour fabriquer de nouveaux ustensiles : une baïonnette est transformée en curette, la poignée d’un arrosoir provient d’une jante de vélo, des branches deviennent des plantoirs. Nécessité fait loi et quand il faut survivre l’imagination n’a pas de limite. Et malgré l’afflux de produits manufacturés ces pratiques vont perdurer. Sur un autre plan, le projet artistique d’Anne Fave et Emmanuel Carquille, La Destination, confronte l’histoire du cinéma et la mémoire du Chemin des Dames dans un travail où le support matériel de la pellicule est transformé par la notion d’usure, de trace, de poussière. Julie Deydier retrace la question du réemploi dans l’art, l’architecture et le design qui commence déjà dès la fin de l’Antiquité mais trouvera une expression nouvelle à partir de l’invention du « ready-made » par Marcel Duchamp en 1913. De nombreuses réflexions contemporaines sur la déconstruction et la réutilisation des matériaux, mettant l’accent sur les ressources locales, renouvellent l’approche sur la durabilité des bâtiments. Au Japon la pratique du kintsugi (réparer et souligner avec délicatesse l’imperfection d’un objet) est lié à une réflexion spirituelle sur l’impermanence des choses. Le détournement, le réemploi ou la réparation font aussi partie intégrante de la réflexion de nombreux artistes contemporains comme Kader Attia. À propos de la littérature, Yves Perrine analyse les différentes ramifications de la notion de palimpseste issue du Moyen-Âge (manuscrit gratté pour laisser la place à d’autres textes) et le rapport aux strates de souvenirs et à la mémoire que cela induit. L’anthologie, le montage, les variantes voire le plagiat, sont autant de types littéraires participant d’une « philosophie » réemploi. Enfin, Claire Feuvrier-Prévotat revient en détail sur l’exposition du musée du Louvre -Lens « Rome, la cité et l’Empire » (2022) qui aborde sous différents angles la question de l’acculturation de la culture gauloise à la culture romaine des années 50 à 25 avant J.-C. Ou comment la mixité entre les deux univers, l’inspiration, l’influence participent d’une nouvelle construction sociale, d’une reconstruction culturelle.
Le panorama que nous vous proposons ici ne peut ni ne se veut exhaustif ; mais il met en relief la force et la pertinence de la question du réemploi, sa permanence de fait, liée intrinsèquement à la question du progrès technique et industriel et comme s’il s’agissait d’un des fondamentaux de l’humanité. Nous assistons bien à un mouvement de fond, à l’affirmation d’une nouvelle culture du réemploi mais issue d’une culture plus ancienne. Le musée de Vassogne s’en fait l’écho.
Patrick DOUCET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2021-2022 : "Sucre et Vous
« Sucre & Vous », la nouvelle exposition du musée de Vassogne propose un voyage étonnant dans l’univers du sucre. L’idée s’est imposée avec le don récent au musée de pièces et de documents relatifs à la sucrerie de Maizy (Aisne) patiemment conservés par son dernier Directeur Jean-Claude Religieux. Un pan entier de l’histoire de la région, finalement assez méconnue, se révélait. La production du sucre de betteraves a marqué et marque les territoires de l’Aisne, de la Picardie et plus largement du nord de la France. Nous avons ainsi redécouvert la complexité de la chaîne humaine et technique qui aboutit à ce petit cube blanc, tellement banal, que nous immergeons dans nos cafés. En conséquence, prolonger cette histoire agricole et industrielle du sucre par l’exploration de ses aspects culturels a semblé une évidence.
En ce sens, le propos de l’exposition s’inscrit pleinement dans la philosophie du musée de Vassogne. Notre sujet fondamental - au-delà de l’exploration de la richesse culturelle des sociétés anciennes liées à l’outil et à ses usages - est d’interroger la complexité et la fécondité du rapport entre enjeux locaux et globaux. Cet aller-retour entre les aspects les plus historiques et les plus contemporains fondent la dynamique du musée. Le contenu de l'exposition est le reflet de textes et thématiques abordés par les auteurs du catalogue :
Claire Feuvrier-Prévotat nous emmène dans l’Antiquité pour comprendre la place du sucre dans ces civilisations anciennes. Nous apprenons que le terme indien khanda (milieu du IIIe siècle av. J.-C.) qui qualifie du sucre en gros cristaux est à l’origine, par l’intermédiaire de l’arabe et de l’italien, du mot « candi ». Surtout, cette étude souligne le rôle de premier plan du miel « porteur du sucre » dans la gastronomie romaine.
Jean-Pierre Boureux, en s’appuyant sur les manuels de cuisine ou les inventaires de pharmacopée du XIème au XVème siècle, analyse l’utilisation du sucre blanc originaire de la canne au Moyen Age. Sa place est importante aussi bien dans la pharmacie que dans la cuisine où il est considéré comme une épice, à une époque où l’on ne sépare pas le sucré et le salé, et où les desserts n’existent pas en tant que tels. Parallèlement, le miel continue d’être un élément clé de l’alimentation, et une recette de préparation du miel rosat nous est livrée.
Guy Marival met en perspective l’histoire de la culture de la betterave, à travers une lecture à la fois historique et contemporaine de la « Notice » de Pierre-Alexandre-Jules Huet-Delacroix, qui fait la promotion de sa culture dès 1812 et qui deviendra l’un des premiers betteraviers de l’Aisne. Il complète cette histoire par celle de la transformation de la betterave, de l’outil à la mécanisation, du champ à l’usine, et par un panorama des sucreries dans l’Aisne depuis le XIXe siècle.
Jean-Claude Religieux nous plonge dans la haute technicité - insoupçonnée par le grand public - de l’industrie de la transformation de la betterave en sucre. Il en détaille avec maîtrise toutes les étapes, depuis les achats jusqu’au conditionnement et à l’expédition. Dernier Directeur de la sucrerie de Maizy, il nous raconte sa saga depuis 1858 jusqu’à sa fermeture en 1997 et nous comprenons à quel point cette histoire est à la fois familiale, entrepreneuriale et profondément ancrée dans celle du territoire de l’Aisne.
Julie Deydier rappelle que le sucre est un plaisir (son étymologie est associée à l’idée de douceur à partir des années 1460) et une culture. Elle parcourt les expressions, la toponymie et les lieux évocateurs du sucre, nous plonge dans les états et les formes du sucre. Le sucre et ses usages inspirent le design des objets, des plus sophistiqués aux plus quotidiens, et nourrissent l’imagination des écrivains et des cinéastes. Le plus surprenant sera de découvrir que le sucre tel qu’en lui-même est matière première de créations artistiques dès la fin du XVe siècle à Venise. L’empreinte culturelle du sucre se révèle multiforme.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à déguster cette exposition que nous à l’avoir concocté, alors : « Sucrez-vous ! ».
Patrick DOUCET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2019-2020 : "Transport d'Exode"
André Malraux décrivant la fuite des Républicains espagnols dans L'Espoir (1937) trouve des mots qui parlent de tous les exodes de l’Histoire et du monde : « Derrière des groupes silencieux passaient des charrettes bosselées de paniers et de sacs, où brillait un instant l'éclat écarlate d'une bouteille; puis, sur des ânes, des paysannes sans visage, et dont pourtant on devinait le regard fixe, avec la séculaire détresse des fuites en Égypte. L'exode coulait, enfoui sous ses couvertures dans cette odeur de feu, scandé par le battement profond et rythmé du canon . »
Quitter son pays. S’arracher à la terre qui vous attache parce qu’elle vous nourrit, parce qu’elle façonne votre activité, parce qu’elle vous donne un métier. Fuir. Comment transporter avec soi son existence pour fuir la peur, l’indicible, l’invivable ? Fuir et chercher refuge ailleurs. Être provisoirement ou définitivement déraciné. Comment se rattacher à une humanité devenue un temps trop précaire, sans but, presque sans objets ?
Ce sont ces questions, aussi anciennes que l’être humain, que le musée de Vassogne a voulu explorer, à sa façon, dans sa nouvelle exposition, « Transports d'exode ». Elle prolonge d’une autre manière le cycle de présentations lié à la Reconstruction et commencé en 2014. L’exode des réfugiés de 1914 est un épisode moins connu de ces années de guerre. « À la fin de la Grande Guerre, le directeur du département des affaires civiles de la Croix Rouge américaine en France, Homer Folks, pouvait écrire : «Il y avait des réfugiés dans toute l’Europe. Pendant cinq ans, c’est comme si presque tout le monde devait partir ou attendait de le faire ». La France n’a pas échappé au phénomène, avec l’accueil sur son territoire de réfugiés étrangers, essentiellement des Belges, et le déplacement de populations originaires des départements du Nord et de l’Est occupés par les Allemands ou militairement menacés . »
Objets et transports d’exodes
Ce sont 170 objets qui sont présentés dans deux espaces.
La première partie raconte les travaux et les jours d’avant la Grande Guerre. L’âne, le cheval et le bœuf forment la trinité de la traction. Ils tirent, ils portent, on les aiguillonne, on les monte. On transporte le grain, le lait, le fromage, le raisin, les pommes de terre, les légumes, le bois, le fumier, les lapins. On le fait à pied, à dos d’homme, à dos d’âne, dans des bâts, en brouette. On porte des hottes, des paniers, des cannes à lait, des cageots. La vie domestique elle aussi se transporte dans toutes sortes de boîtes car il faut bien aller parfois d’une maison ou d’un village à l’autre : boîtes de dentellière, de colporteur, à clous, pour le rangement, pour la chapelure. Et pour les jours de fêtes, le surjoug coloré du bœuf égaie, par le son mat et précis de ses cloches, la dure vie des gens de la terre.
La deuxième partie nous entraîne sur les chemins de l’exode. Tous les contenants possibles - malle, paniers, valises - sont chargés sur les premiers véhicules que l’on trouve : brouette, motobécane, charrette, porte charge...
Objets de rien, objets de tout
Emportés dans les grands flux tragiques de l’Histoire, les frêles objets présentés dans l’exposition « Transports d'exode » parlent de la fragilité des vies quotidiennes. Ce sont les vestiges de vies ordinaires bouleversées qui basculent dans le transitoire. Objets de rien, rendus anodins par le fil des jours, ils auraient pu, recouverts de poussière au fond des remises, être oubliés. Mais par le propos de cette présentation, de fragiles ils deviennent graciles. Polis par le temps, ils se transforment en d’extraordinaires reflets de vies devenues extraordinaires. Ils deviennent objets de tout. Objets de rien, objets de tout, c’est le cœur de la vocation du Musée de Vassogne.
Patrick DOUCET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017-2018 : "Paysages de la Reconstruction (1919-1939)"
Dans le cadre du Centenaire de la Guerre de 1914-1918, le musée de Vassogne présente sa nouvelle exposition, « Paysages de la Reconstruction (1919-1939) » du 1er avril 2017 au 31décembre 2018. C’est le deuxième volet du cycle que le musée de Vassogne consacre à la Reconstruction sur le Chemin des Dames après 1918. La première partie, « Le Chemin de la reconstruction (1919–1939) » (avril 2015-décembre 2016) a été consacrée à la reconstruction de l'habitat et à la réhabilitation des liens sociaux sur le Chemin des Dames dans l’après-guerre. « Paysages de la Reconstruction » aborde la question de la reconquête des terres et des cultures par les habitants entre 1919 et 1939. L’exposition explore le nouveau visage des jardins et des paysages sous un angle inédit : comment rendre sensible tous les aspects de la société sur le Chemin des Dames après « l'évènement ruine » ? « L'évènement ruine » est précisément le terme que Stéphane Bedhome - fondateur et conseiller scientifique du musée - a forgé dans sa thèse et son livre pour caractériser l’état de dévastation et de sidération de la région après la Grande Guerre.
La Reconstitution agricole
La reconstitution agricole est un enjeu qui touche particulièrement le Chemin des Dames, cette partie de l’Aisne labourée, dévastée, aplatie par la guerre. Les exploitants et l’administration - nationale et locale - ont plusieurs priorités : la remise en état des terres, la reconstitution des cadastres, le retour aux rendements d’avant-guerre et la consolidation des structures de production. L’équipement agricole et l’approche départementale du progrès sont les deux composantes pour comprendre les mécanismes de la modernisation agricole.
« Saisons »
L’exposition, « Paysages de la Reconstruction », est divisée en trois parties. La première, sous-titrée « Saisons », met en scène l’ensemble des outils et des objets qui a contribué à la remise en état du milieu physique. L’été, l’automne, l’hiver et le printemps, les quatre saisons de 1920 sont évoquées au travers de centaines de pièces des années 1920 qui proviennent du Conservatoire du Musée de Vassogne. : charrues, bêches, houes, arrosoirs, échalas, cueilles-pommes, pioches, paniers…
« Paysages d’après-guerre »
La deuxième partie intitulée « Paysages d’après-guerre » offre quatre visions des paysages de l’avant à l’après-guerre. « Le monde ancien avait totalement disparu » montre un ensemble de photographies inédites de personnages et paysages avant 1914. « Regarder, lire et écrire les paysages » présente des témoignages de ces paysages des années 1920 sur le Chemin des Dames : paysages de visages, paysages de cartes postales, photos de lieux.... « Nouvelle lecture de la culture » rend compte des progrès techniques et de la volonté de former les agriculteurs au monde de demain. « Paysages d’objets » met en gloire plusieurs centaines d’outils agraires, exemplaires uniques et représentatifs de cette période.
« Par delà les toits… »
La troisième partie de l’exposition, « Par delà les toits… », plonge le visiteur dans une vision onirique du monde ancien. Le paysage était formé à la fois par les champs, les cultures, les jardins et les habitations, leurs volumes, leurs toits, leurs girouettes… C’est cette part du paysage, englouti par la guerre, à la limite du ciel et de la terre, qu’évoque un ensemble d’objets constitué d’éléments de toitures, épis de faîtage, tuiles, chatières de ventilation…
Les plaques de verre de Françoise Perronno
2017 marque pour le musée de Vassogne le début d’une démarche de collaboration avec des artistes contemporains. Pour « Paysages de la Reconstruction » le musée de Vassogne a choisi de travailler avec Françoise Perronno, artiste plasticienne. Sa démarche de ré-interprétation de paysages sur des plaques de verre s’inscrit naturellement dans le propos de l’exposition. S’inspirant des paysages même du Chemin des Dames, de l’avant-guerre à aujourd’hui, Françoise Perronno les redessine : champs sans fin, labours, lignes d'horizon, ciels, arbres, forêts, collines,… Le dessin, pris entre les deux plaques de verre, est révélé par un jeu d’ombre et de lumière. Les paysages sont aussi des passages entre l’ancien monde et celui d’aujourd’hui.
Patrick DOUCET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015-2016 : "Le Chemin de la Reconstruction (1919-1939)"
La nouvelle exposition du musée de Vassogne « Le chemin de la reconstruction 1919-1939 » constitue une sorte de pari inédit : comment évoquer, comment rendre sensibles tous les aspects de la société sur le Chemin des dames après « l'évènement ruine » ? « L'évènement ruine » est le terme que Stéphane Bedhome - fondateur du musée - a forgé dans sa thèse et son livre pour caractériser l’état de dévastation et de sidération de la région après la Grande guerre. L’ampleur de ce sujet imposait qu’il soit traité en un prologue et deux volets. « Terres, fêlures de la Grande Guerre » est le prologue de ce cycle : évocation symbolique du bouleversement de la terre par la guerre, du passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Le premier chapitre du «Chemin de la reconstruction" (avril 2015-décembre 2016) présenté ici, est consacré à la reconstruction de l'habitat et à la réhabilitation des liens sociaux sur le Chemin des Dames après 1918. Le deuxième chapitre (avril 2017-décembre 2018) parlera de la reconquête des terres et des cultures, du nouveau visage des jardins entre 1919 et 1939.
«Le chemin de la reconstruction 1919-1939 » est divisé en deux parties. La première met en scène l’ensemble des métiers qui ont contribué à la reconstruction matérielle des bourgs et des villages : maçons, charpentiers, plâtriers, couvreurs… La richesse des techniques et des savoirs-faire confirme, si besoin était, que les fonctions et formes de l’outil sont aussi l’expression d’une pensée ouvrière singulière.
La deuxième partie, consacrée à la société de la reconstruction, est divisée en quatre sections. « Dommages » rend compte de la complexe machine administrative mise en place par l’Etat pour aider les régions dévastées et les populations. « Entrepreneurs et ouvriers » évoque le travail au jour le jour de l’entreprise Maroteaux-Cabaret et de ses employés - « Intérieurs et cafés » montre les éléments parfois rudimentaires de la vie quotidienne dans les maisons et les cafés-épiceries. « Fêtes et cérémonies » parle des commémorations laïques et religieuses, marques incontournables d’une sociabilité retrouvée.
Enfin il était impossible d’envisager cette présentation sans la présence du livre de Roland Dorgelès Le réveil des morts, paru en 1923, terrible évocation de ce travail physique et moral de la reconstruction. Il nous a fortement inspiré. Nous l’avons placé au début de cette seconde partie, en vis-à-vis de simples persiennes en bois, caractéristiques des nouvelles habitations. Nous avons ainsi tracé une ligne symbolique, celle d’un chemin, le chemin du renouveau.
Patrick DOUCET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013-2014 : "Du Blé, récoltes et pratiques fiscales"
La réforme du système fiscal est aujourd’hui dans toutes les bouches. Justice, équité, proportionnalité sont autant de termes qui nourrissent la chronique. Le phénomène n’est pas nouveau et plonge ses racines dans un riche terreau historiographique. De l’Empire Romain aux mondes médiévaux, en passant par nos républiques successives, l’impôt ne cesse d’être discuté, réformé, réorganisé, donnant bien souvent le sentiment d’un empilement de réformes symptomatiques des états en proie aux blocages structurels.
« Du Blé » tente d’illustrer la transformation d’une récolte de grains en une valeur marchande prélevable en nature.
Cette exposition originale propose un panorama des pratiques fiscales liées au grain dans la France de l’Ancien Régime tout en invitant le spectateur à une remise en perspective des difficultés que nous rencontrons aujourd’hui. Elle questionne par ailleurs, par l’objet, les pratiques sociales et culturelles à la veille de la Révolution Française.
Tout commence par la récolte des « grains d’or ». Le tranchant des faucilles, sapes et faux est alors à l’œuvre pour coucher l’épi. Puis vient la mise en bottes, le battage et dépiquage puis le stockage du grain qui fera vivre, parfois survivre les familles. Coffins, onglets, aiguilles à botteler, tribulum, fléaux, batadères seront les fleurons d’une armada d’objets anciens, parfois très anciens, n’étant aujourd’hui guère connus.
Puis vient la mesure illustrée par ces réceptacles à grain qui ont traversé les époques et rendent compte des profonds changements sociaux économiques qui ont touché la France de la fin de l’Ancien régime au milieu du XXème siècle. Elles rendent par ailleurs compte d’une France qui se structure et se restructure : mesures seigneuriales, mesures de l’impôt royal (taille) puis uniformisation du système des poids et mesures qui, jusqu’à nos jours, a permis de faciliter les échanges en évitant un fastidieux travail de conversion.
Cette nouvelle exposition au Centre Historique du Monde du Travail répond aux inquiétudes de notre temps. Puisés dans un passé souvent lointain, ces objets transpirent une époque désormais révolue tout en invitant à des questionnements d’actualité.
Stéphane BEDHOME
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011-2012 : "Mouches à Miel"
Les abeilles se meurent…Devrons nous dire demain les abeilles ne sont plus ? Chaînon indispensable de la fécondation des fruits, des légumes ou des céréales, les abeilles s’éteignent progressivement depuis quinze ans. La production de miel, elle, a chuté de moitié… Notre arrogance nous rendra-t-elle responsable de cette hécatombe ?
Mariel Jean-Brunhes Delamarre , ethnologue et chercheuse du musée des Arts et Traditions populaires de Paris, s’est intéressée au «berger des abeilles » . On pourrait dire certes, que « le berger est parvenu à rendre ses moutons dépendants de leur maître mais l’apiculteur est, au contraire, en grande partie dépendant des « mouches à miel ». L’expérience de la guerre dans nos régions nous a appris cependant qu’une ruche abandonnée est une ruche perdue, assertion confirmée par une vieille croyance occitane qui veut qu’à la mort du chef de famille, il faille aussitôt consoler et raisonner les abeilles, afin qu’elles ne quittent pas le rucher .
Cette exposition originale propose une rétrospective des habitats divers et variés de ces reines du miel. De terre, de paille, de pierre, de bois, la ruche est le symbole du foisonnement de bourdonnements entourant le rucher. Ces mâts de cocagne d’une société ailée imaginés par l’homme depuis la nuit des temps sont d’une variété architecturée soignée et confondante. Ces villages de ruches aux visages si singuliers, hantent encore certaines pentes des monts Lozère, col du Lautaret ou versants abrupts des Pyrénées. Ils sont aussi une évocation d’autres types d’habitat, notamment humain, que l’on retrouve sur le continent Africain et Européen. Ces ruches s’inscrivent dans la lignée d’un savoir faire ancestral qui se conjugue bien souvent en harmonie avec le respect dû à ces insectes. Disons néanmoins que l’exploitation des ruches les plus archaïques entraînait la destruction d’une part non négligeable de l’essaim.
Le travail autour des ruches est aussi évoqué : presses à miel, couteaux à désoperculer, pots à miel, enfumoirs à abeilles seront les fleurons d’une armada d’objets anciens, parfois très anciens, n’étant aujourd’hui guère connus.
Cette nouvelle exposition au Centre Historique du Monde du Travail répond aux inquiétudes de notre temps. Puisés dans un passé souvent lointain, ces objets transpirent une époque désormais révolue tout en invitant à des questionnements d’actualité.
Stéphane BEDHOME
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010-2011 : "SCIES / BEMOL. Itinéraire d'un collectionneur"
Une exposition en hommage au collectionneur passionné qu’était Jean Paul Van Der Linden. Présentation des objets de sa collection.
Jean Paul Van Der Linden est né le 19 janvier 1953 à Châlons-sur-Marne. Suite au décès de son père, il est placé ainsi que ses deux frères et sa sœur dans des familles d’accueil dans le vignoble champenois. Jean-Paul est un enfant studieux et appliqué. Dès l’obtention de son BEPC, il poursuit ses études au lycée Roosevelt de Reims. Le jour de ses 17 ans, il décide de s’engager à titre provisoire dans l’armée (402 RA à Laon). Il obtient la résiliation de son contrat en septembre 1972. Il trouve très rapidement un emploi à la sucrerie de Guignicourt où il fera toute sa carrière jusqu’à la découverte de sa maladie en septembre 2007. Marié en 1973, il aura deux fils : Stéphane en 1974 et jérôme en 1976.
Sa passion pour les objets anciens lui est venue bien avant son mariage. Il possédait déjà des lampes tempêtes, des lampes au carbure et de nombreux autres objets. Très rapidement, il se met en quête d’accroître les fragments de collection déjà constitués. Il fréquentait avec son épouse les « halles du Boulingrin » les jours de brocante et se levait avant l’aube pour aller chiner. Chiner, certes, mais aussi se documenter : il achetait beaucoup de livres et aimait connaître l’histoire des objets et de leurs possesseurs. « Une année, nous sommes rentrés d’Auvergne avec deux araires et un joug de bœuf sur le toit de la voiture, objets qu’il avait achetés à un paysan dans l’optique de les sauver. Je soupçonne que nos destinations de vacances étaient choisies en fonction de ce qu’il allait pouvoir trouver d’insolite ». Il a exposé ses outils et objets à Condé sur Suippe (cf. doc. ci-contre) et à Chaudardes. Pédagogue, il aimait éveiller la curiosité des enfants pour les objets.
Stéphane BEDHOME